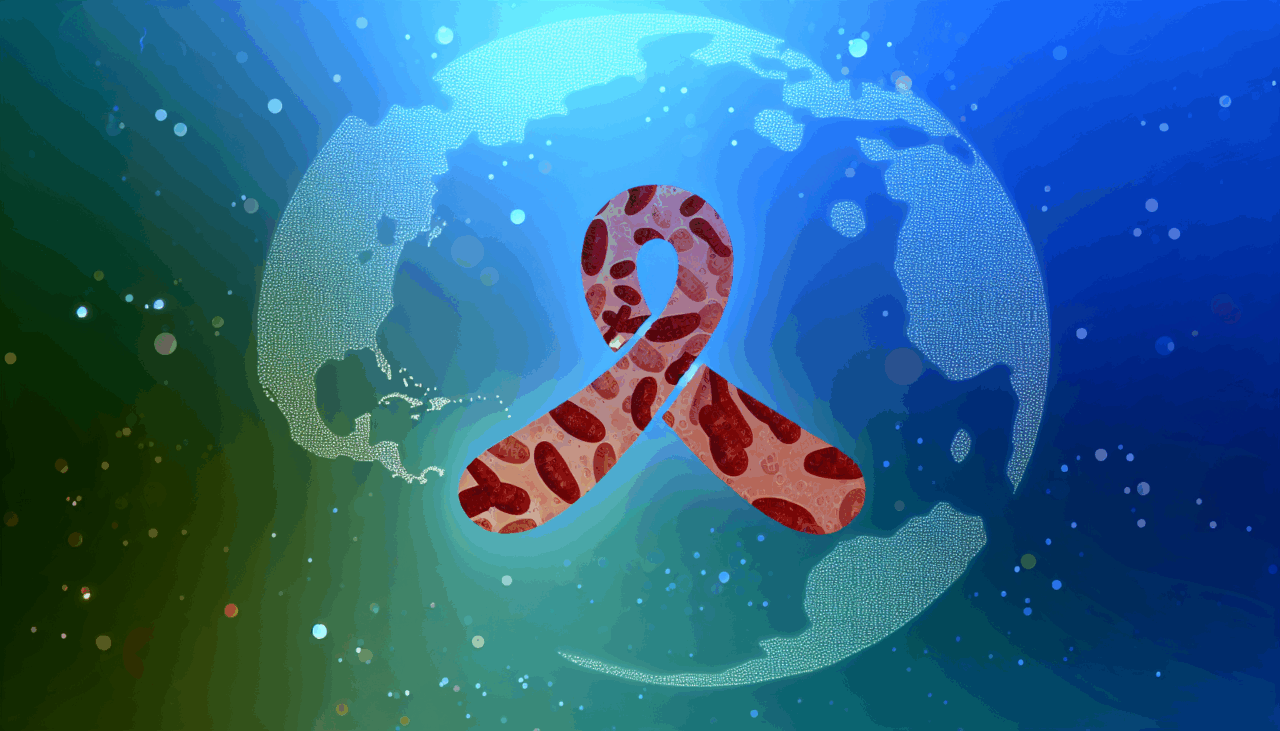Contexte
Le carcinome épidermoïde de l’œsophage (CEÉ) représente un problème de santé publique majeur en Afrique du Sud, se classant parmi les cancers les plus mortels. Parmi les facteurs de risque connus, le papillomavirus humain (HPV) est fortement associé aux cancers épidermoïdes, notamment ceux du col de l’utérus, de l’anus et de l’oropharynx. Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) augmente la susceptibilité aux cancers liés au HPV. Cependant, l’impact de la co-infection par ces deux virus sur le CEÉ dans les populations sud-africaines reste flou. Cette étude visait à déterminer la prévalence du HPV et du VIH chez les patients atteints de CEÉ.
Méthodes
Un total de 78 patients atteints de CEÉ ont été recrutés prospectivement entre janvier 2022 et décembre 2024 à l’hôpital académique Steve Biko à Pretoria, en Afrique du Sud. Les participants ont été testés pour le VIH, et des biopsies tumorales ont été réalisées par endoscopie. L’ADN a été extrait de spécimens de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), et la détection et le génotypage du HPV ont été effectués. Les analyses statistiques ont été réalisées avec Stata 18, en utilisant des tests du chi carré et une régression logistique pour évaluer les associations, avec un seuil de signification de p ≤ 0,05.
Résultats et discussion
La population étudiée était majoritairement composée d’Africains noirs (96 %), avec 55 % d’hommes et 45 % de femmes, âgés de 34 à 86 ans. L’infection par le VIH était présente chez 42,3 % (n=33) des patients. L’ADN du HPV à haut risque a été détecté dans 56,4 % (n=44) des cas de CEÉ, les sous-types à haut risque HPV16 et HPV18 étant les plus fréquents, trouvés respectivement dans 68 % et 41 % des cas positifs au HPV. La co-infection par le VIH et le HPV a été observée chez 23,1 % (n=18) des patients. Cependant, les analyses statistiques n’ont montré aucune association significative entre le statut VIH et HPV chez les patients atteints de CEÉ (p = 0,78). Une tendance vers une corrélation a été notée entre le statut VIH et la positivité au HPV18 (p ajusté = 0,051).
Conclusion
Bien qu’aucune association directe entre le VIH et le HPV dans le CEÉ n’ait été trouvée, la forte prévalence du HPV à haut risque, en particulier HPV16 et HPV18, souligne la nécessité de recherches supplémentaires. Étant donné le fardeau du VIH et du HPV en Afrique du Sud, des études multicentriques plus larges sont essentielles pour mieux comprendre les contributions virales à la carcinogenèse œsophagienne.
Les statistiques de GLOBOCAN 2022 montrent que le cancer de l’œsophage est la septième cause de mortalité par cancer dans le monde, bien qu’il soit la onzième forme de cancer la plus répandue. Il existe deux principaux sous-types histologiques : le carcinome épidermoïde de l’œsophage (CEÉ) et l’adénocarcinome, qui présentent des distributions régionales distinctes. L’adénocarcinome est plus courant en Amérique du Nord et en Europe occidentale, tandis que le CEÉ prédomine en Afrique et en Asie. Le CEÉ représente environ 85 % des cas mondiaux de cancer de l’œsophage, tandis que l’adénocarcinome ne représente que 14 %. Les taux d’incidence les plus élevés de CEÉ ont été observés en Asie de l’Est, suivis de l’Afrique de l’Est et du Sud. En 2021, l’étude Global Burden of Disease a identifié l’Asie de l’Est, l’Afrique subsaharienne méridionale et orientale comme les régions ayant les taux d’incidence standardisés selon l’âge les plus élevés pour le cancer de l’œsophage.
L’Afrique du Sud a connu une augmentation constante de l’incidence du carcinome œsophagien au cours des dernières décennies. Cela a été attribué à des changements dans l’alimentation, le mode de vie et une exposition croissante aux agents cancérigènes ; en conséquence, le pays fait actuellement face à un fardeau particulièrement élevé de CEÉ, avec des taux d’incidence disproportionnellement élevés dans le Cap oriental, le KwaZulu-Natal et certaines parties de la province du Gauteng. Ce cancer est souvent découvert à un stade avancé, ce qui conduit à un mauvais pronostic. Un rapport statistique sud-africain pour l’année 2019 a montré que, bien que le cancer de l’œsophage soit le huitième cancer le plus courant dans le pays, il était responsable d’un tiers des décès par cancer chez les hommes.
Les facteurs de risque établis pour le CEÉ incluent la susceptibilité génétique, les carences alimentaires (comme une faible consommation de fruits et légumes), l’irritation chronique de l’œsophage (par exemple, due à des boissons chaudes), les troubles métaboliques, le tabagisme, la consommation d’alcool et les infections virales. Parmi les facteurs de risque viraux, l’infection par le papillomavirus humain (HPV), en particulier les sous-types à haut risque HPV16 et HPV18, a été impliquée dans la carcinogenèse œsophagienne. Le HPV est bien établi comme un agent cancérigène dans les cancers du col de l’utérus, anogénitaux et oropharyngés, et des mécanismes similaires — les oncoprotéines virales E6 et E7 inactivant les protéines suppresseurs de tumeurs p53 et pRb — sont censés contribuer au développement du CEÉ. Cependant, bien que le HPV ait été détecté dans des régions à forte incidence de CEÉ, sa prévalence reste faible dans les régions à faible incidence de CEÉ.
L’Afrique du Sud a l’un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, avec environ 12,7 % (8 millions de personnes) vivant avec le VIH en 2024, et est créditée du plus grand programme de thérapie antirétrovirale (ART) au monde. L’immunosuppression liée au VIH est censée augmenter la susceptibilité aux infections oncogènes telles que le HPV et les virus de l’hépatite, réduire la clairance immunitaire des cellules malignes et accélérer la carcinogenèse. Bien que l’adoption généralisée de l’ART ait amélioré les taux de survie des personnes vivant avec le VIH (PLWHIV), elle a également conduit à une augmentation des cancers non définis par le SIDA (NADCs), en particulier les malignités associées aux virus tels que les cancers induits par le HPV, y compris le CEÉ.
En Afrique du Sud, la relation entre le VIH, le HPV et le CEÉ reste insuffisamment explorée. Étant donné le fardeau du VIH, du HPV et du CEÉ dans le pays, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’immunosuppression associée au VIH augmente le potentiel oncogène du HPV dans l’œsophage, comme c’est le cas dans le cancer du col de l’utérus. Cette étude vise à décrire la prévalence de ces deux infections virales dans une population sud-africaine atteinte de CEÉ en analysant la prévalence et le génotype du HPV dans le tissu tumoral, en quantifiant la proportion de co-infections virales et en évaluant si la positivité au VIH est associée à une plus grande probabilité de détecter également le HPV dans les tumeurs.
Cette étude était une étude transversale menée à l’hôpital académique Steve Biko (SBAH), un centre de référence tertiaire affilié à l’Université de Pretoria. Le SBAH est situé à Pretoria, Gauteng, Afrique du Sud et est l’un des trois hôpitaux universitaires de la province ; il dessert les patients de la région centrale et orientale de Pretoria et de la province de Mpumalanga. L’approbation éthique a été obtenue du Comité d’éthique de la recherche de l’Université de Pretoria (Référence éthique n° : 296/2021) et du Département de la santé du Gauteng (Réf. NHRD n° : GP_202107_062).
Un total de 104 patients consécutifs présentant des caractéristiques cliniques suggérant un cancer de l’œsophage au Département de chirurgie du SBAH ont été recrutés prospectivement entre janvier 2022 et le 15 décembre 2024. Les patients ont subi une prise d’antécédents médicaux basée sur un questionnaire, y compris des questions sur leur statut VIH ; et après avoir obtenu le consentement éclairé nécessaire, un échantillon de sang a été prélevé pour le test VIH en utilisant le test immuno-enzymatique (ELISA) chez ceux qui ne prenaient pas déjà de thérapie antirétrovirale (ART) pour le VIH. Chaque patient a subi une œsophagogastroscopie, au cours de laquelle plusieurs biopsies aléatoires ont été collectées à partir de tumeurs à l’aide de pinces à biopsie endoscopiques jetables standard à usage unique. Les spécimens de biopsie ont été immédiatement fixés dans du formol tamponné à 10 % et envoyés pour évaluation histopathologique par les Services nationaux de laboratoire de santé (NHLS), Division académique de pathologie de Tshwane. Sur les 104 patients recrutés, 78 patients ont satisfait aux critères d’inclusion et ont été inclus dans la cohorte finale de l’étude, et vingt-six (26) patients ont été exclus. Les critères d’inclusion étaient la confirmation histologique du carcinome épidermoïde de l’œsophage (CEÉ) et le statut VIH objectivement confirmé (soit déjà sous ART, soit confirmé via ELISA). Les patients exclus comprenaient dix-huit (n=18) adénocarcinomes à l’histologie, cinq (n=5) ont refusé le test VIH et trois (n=3) ont été exclus en raison de résultats de biopsie manquants. La figure 1 fournit un diagramme de flux décrivant la sélection des patients.
Figure 1. Diagramme de flux de la répartition des patients : Tous les 78 patients inclus ont été testés pour les infections au HPV. Bien qu’un nombre significatif d’individus aient été infectés par le VIH ou le HPV individuellement, seuls 23 % (n=18) des patients avaient une co-infection par les deux virus. Pour les trois patients sans histologie, leurs spécimens et résultats n’ont pas pu être retrouvés dans la base de données des résultats du NHLS et les patients ont été perdus de vue, et en tant que tels, des biopsies répétées n’ont pas pu être effectuées.
Pour l’histologie conventionnelle, le traitement des tissus a été initié à 40°C en utilisant une solution de formaldéhyde tamponnée à 10 %, suivie d’une exposition à des solutions d’alcool graduées. Un agent de clarification a été appliqué dans un rapport 50:50 avec de l’alcool absolu, suivi d’un processus de clarification en deux étapes. Le tissu a ensuite été infiltré avec de la cire de paraffine fondue en trois étapes à 60°C. Les programmes de traitement automatisés ont exposé les échantillons de tissus à différentes solutions à des intervalles de 15 à 45 minutes, selon la taille des fragments. Des sections de 4 microns d’épaisseur ont été obtenues à l’aide de la microtomie à lame d’acier. Une coloration à l’hématoxyline et à l’éosine a été réalisée, avec un bleuissement nucléaire intermittent utilisant l’eau de Scot et un rinçage subséquent. Cela a été suivi par une exposition à des solutions d’alcool graduées, une clarification et un montage.
Après confirmation histologique du CEÉ, les blocs de tissus FFPE ont été récupérés. Le premier lot de 49 blocs FFPE a été récupéré et traité en avril 2024 et le dernier lot (n=29) a été récupéré et traité en décembre 2024. Pour la coupe, les sections ont été coupées en rouleaux d’une épaisseur de 8 μm. Pour minimiser la contamination croisée, les sections ont été coupées à partir de chaque bloc de tissu en utilisant une nouvelle lame propre et stérile sur un microtome pour chaque échantillon. La nouvelle lame et la surface de coupe ont été nettoyées avant et après la coupe avec de l’hypochlorite de sodium à 10 % suivi d’éthanol à 70 % et de solution d’élimination de l’ADNase. Les 2 à 3 premières sections coupées de chaque bloc d’échantillon ont été éliminées. Les rouleaux ont ensuite été placés dans des tubes microcentrifugeurs stériles de 2 ml. L’ADN a été extrait de ces sections en utilisant le kit QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen, Cat. No. 56404, Hilden, Allemagne) selon le protocole du fabricant, avec de légères modifications. En bref, les sections FFPE ont été déparaffinées en ajoutant 1 ml de xylène, en vortexant pendant 10 secondes et en centrifugeant à 15000g pendant 2 minutes à température ambiante. Le surnageant a été soigneusement retiré sans perturber le culot. Le xylène résiduel a été lavé avec 1 ml d’éthanol absolu, suivi d’un vortex et d’une centrifugation à pleine vitesse pendant 2 minutes. L’éthanol a ensuite été évaporé par incubation à 37°C. Le culot a été resuspendu dans 180 μl de tampon ATL (tampon de lyse des tissus animaux), mélangé avec 20 μl de protéinase K et incubé à 56°C pendant la nuit pour une digestion complète des tissus.
Après une centrifugation de 30 secondes, 200 μl de tampon AL (tampon de lyse) et 200 μl d’éthanol à 100 % ont été ajoutés séquentiellement avec vortex. Le lysat a été transféré sur une colonne QIAamp MiniElute dans un tube de collecte de 2 ml et centrifugé à 8000g pendant 1 minute. La colonne a été lavée séquentiellement avec 500 μl de tampon AW1 (tampon de lavage 1) et de tampon AW2 (tampon de lavage 2), chacun suivi d’une centrifugation à 8000g pendant 1 minute. Une centrifugation finale a été effectuée à 15 000 g pendant 3 minutes. La colonne a ensuite été placée dans un tube microcentrifuge propre, et l’ADN a été élué en ajoutant 50 μl de tampon ATE (tampon d’élution aqueux), en incubant à température ambiante pendant 1 minute et en centrifugeant à 15 000 g pendant 1 minute. Pour une récupération optimale de l’ADN, une incubation prolongée de 5 minutes avant l’élution a été recommandée. L’ADN extrait a été stocké à -20°C pour des applications en aval telles que la PCR quantitative (qPCR).
Avant l’analyse qPCR, la concentration d’ADN a été mesurée à l’aide du spectrophotomètre BioDrop μlite+ (Harvard Bioscience Inc. Holliston, Massachusetts, USA) et ajustée selon le protocole pour une amplification précise. La détection et le génotypage du HPV ont été réalisés à l’aide du kit Sacace HPV 14 Screening & 16,18,45 Typing Real-TM Quant PCR (Sacace Biotechnologies, Como, Italie). Chaque réaction PCR de 25 µL contenait 40 ng/μl d’ADN génomique, 1x PCR-mix-1-FRT HPV 14, PCR-mix, 0,5 μl de TaqF DNA Polymerase.
Les réactions de contrôle comprenaient 10 μl de QS HPV C1 et QS HPV C2 pour le génotypage des HPV 16, 18 et 45, ainsi que 10 μl du réactif de contrôle négatif.
La PCR a été réalisée avec les conditions suivantes : dénaturation initiale à 95°C pendant 15 minutes, suivie de 45 cycles de dénaturation à 95°C pendant 30 secondes, d’hybridation/extension à 60°C pendant 25 secondes, avec détection de fluorescence.
La fluorescence a été enregistrée à 60°C en utilisant les canaux Joe (Jaune)/HEX, Fam (Vert), Rox (Orange) et Cy5 (Rouge). Des courbes standard ont été générées en utilisant des standards quantitatifs, et les niveaux d’ADN du HPV dans les échantillons cliniques ont été déterminés en comparant l’intensité de fluorescence à la courbe standard.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant Stata 18 (StataCorp LLC, College Station, Texas, USA). Les relations entre le CEÉ, l’infection par le VIH, l’infection par le HPV et la co-infection par le VIH et le HPV ont été évaluées, ainsi que les variables démographiques en utilisant des tests du chi carré ou des tests exacts de Fisher lorsque les comptes de cellules attendus étaient faibles. La procédure de Benjamini-Hochberg a été appliquée pour ajuster les valeurs p pour les tests multiples avec un taux de fausse découverte (FDR) fixé à 5 %. Les variables avec des valeurs p ajustées <0,05 ont été considérées comme statistiquement significatives. Une régression logistique univariée et une régression logistique pénalisée de Firth ont été réalisées pour évaluer l'association entre le statut d'infection par le HPV ou le VIH et les facteurs de risque sélectionnés, en ajustant pour les facteurs de confusion potentiels le cas échéant, tout en tenant compte de la petite taille de l'échantillon et de la faible variabilité. Les données manquantes ont été traitées en utilisant une analyse de cas complets pour tous les modèles de régression. Les analyses descriptives ont inclus toutes les données disponibles par variable. Tableau 1 présente les caractéristiques démographiques, de mode de vie et cliniques de la cohorte étudiée. Soixante-dix-huit patients (N=78) diagnostiqués avec un CEÉ et avec un statut VIH connu ont été inclus dans l'analyse finale. La majorité (96,2 %, n=75) étaient d'origine africaine noire. Les hommes représentaient 55,1 % (n=43) de la cohorte, tandis que les femmes représentaient 44,9 % (n=35). Les âges des patients variaient de 34 à 86 ans. La distribution par âge montrait que 87 % des patients avaient plus de 50 ans, tandis que les 13 % restants avaient 50 ans ou moins. En termes de statut VIH, 42,3 % des patients étaient séropositifs, tandis que 57,7 % étaient séronégatifs. L'infection par le HPV a été trouvée chez 56,4 % des patients ; 38,5 % des individus positifs au HPV étaient infectés par le HPV16, et 23,1 % par le HPV18. Les habitudes alimentaires ont révélé que 87,2 % des patients consommaient des produits à base de maïs comme aliment de base. Seule une petite proportion de patients a déclaré manger du riz (5,1 %) ou des pâtes (1,4 %). Environ 71,8 % des patients consommaient régulièrement des boissons chaudes, tandis que 65,4 % ont déclaré manger fréquemment des légumes. En termes de comorbidités, 23 patients avaient au moins une condition comorbide, l'hypertension étant la plus courante, représentant 69,6 % de toutes les comorbidités. Un antécédent de cancer dans la famille a été rapporté par 11,5 % des patients. La consommation d'alcool a été rapportée par 44,2 % des patients, tandis que 41,0 % ont déclaré fumer. Chez un patient, l'historique de la consommation d'alcool ou des comorbidités n'a pas été capturé dans le questionnaire. Le tableau 1 ci-dessous présente les caractéristiques démographiques de la cohorte de patients. Tableau 1. Caractéristiques démographiques et cliniques des patients atteints de CEÉ. Environ 42,3 % des patients étaient infectés par le VIH, tandis que l'infection par le HPV a été détectée chez 56,4 % (n=44). Les souches de HPV les plus prévalentes dans cette cohorte étaient le HPV16 et le HPV18, représentant respectivement 68,2 % et 40,9 % des cas positifs au HPV. La co-infection par le VIH et le HPV a été identifiée chez 18 patients. Parmi les 44 individus testés positifs pour le HPV, 7 (15,9 %) étaient co-infectés par le HPV16 et le HPV18, tandis que 37 (84,1 %) ont été testés négatifs pour une infection simultanée par le HPV16 et le HPV18. Le HPV45 a été détecté dans quatre échantillons, tandis que deux échantillons ont été testés positifs pour plusieurs souches, y compris le HPV31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 et 68. La majorité du groupe n'avait pas de co-infections par le VIH et le HPV, ni de coexistence significative des deux souches de HPV les plus prévalentes, à savoir le HPV 16 et 18. Sur l'ensemble de la cohorte de 78 patients, seuls 23,1 % ont été trouvés simultanément infectés par les deux virus, tandis que seuls 15,9 % du groupe positif au HPV avaient à la fois le HPV16 et 18. Un test du chi carré a été utilisé pour évaluer la relation entre le statut VIH et l'infection par le HPV chez 78 patients atteints de carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEÉ). Le tableau 2 montre qu'il n'y avait aucune preuve d'association entre le statut VIH et HPV (p = 0,776). Parmi les patients séropositifs, 18 (40,9 %) étaient infectés par le HPV, avec une fréquence anticipée de 18,6, donnant une contribution au chi carré de 0,02, tandis que 15 patients séropositifs (44,1 %) étaient négatifs au HPV, avec une fréquence attendue de 14,4 et une contribution similaire de 0,02. De plus, 26 (59,1 %) des personnes séronégatives étaient positives au HPV, avec une fréquence attendue de 25,4, contribuant 0,01. De même, 19 patients séronégatifs (55,9 %) n'étaient pas infectés par le HPV, ce qui est conforme à la fréquence attendue de 19,6 et a contribué 0,02 à la statistique du chi carré. Dans l'ensemble, la valeur du chi carré était de 0,08 avec 1 degré de liberté, et la taille de l'effet (V de Cramér) était de 0,03. Tableau 2. Analyse du chi carré de l'association entre le statut VIH et l'infection par le HPV chez les patients atteints de CEÉ. Nous avons mené des analyses statistiques supplémentaires pour examiner les associations entre les virus individuels et divers facteurs chez les patients atteints de CEÉ (Tableau 3). Une analyse du chi carré a été réalisée pour évaluer la relation entre le statut VIH et les facteurs démographiques, de mode de vie et cliniques, et la procédure de Benjamini-Hochberg a été appliquée pour contrôler le taux de fausse découverte à 5 %. Après ajustement pour les comparaisons multiples, seul le tabagisme est resté significativement associé au statut VIH (p ajusté = 0,045). Plus précisément, 60,6 % (20/33) des patients séropositifs ont déclaré fumer, contre 26,7 % (12/45) des patients séronégatifs. Tableau 3. Analyse du chi carré des facteurs démographiques, de mode de vie et cliniques par statut VIH chez les patients atteints de CEÉ. Une analyse du chi carré a été réalisée pour évaluer l'association entre le statut HPV et divers facteurs démographiques, de mode de vie et cliniques chez les patients atteints de CEÉ (Tableau 4). Les résultats n'ont montré aucune association significative entre le statut HPV et le sexe, le groupe d'âge, la race, le régime alimentaire de base, la consommation de légumes, la consommation de boissons chaudes, les comorbidités, les antécédents familiaux de cancer, la consommation d'alcool, le tabagisme ou l'utilisation combinée d'alcool et de tabac. En raison de petits comptes attendus, le test exact de Fisher a été appliqué pour la race. Pour contrôler les comparaisons multiples, les valeurs p ont été ajustées en utilisant la procédure de taux de fausse découverte de Benjamini-Hochberg (FDR). Les valeurs p brutes étaient systématiquement élevées, entraînant des valeurs p ajustées uniformément élevées de 0,842 pour toutes les variables sauf la race, qui avait une valeur p brute et ajustée de 1,000. Étant donné cette uniformité et l'absence de signification statistique, les valeurs p ajustées ne sont pas présentées dans le tableau 4 mais sont rapportées ici pour la transparence. Tableau 4. Analyse du chi carré des facteurs démographiques, de mode de vie et cliniques par statut HPV chez les patients atteints de CEÉ. Nous avons également réalisé à la fois une régression logistique univariée et une régression logistique de Firth pour évaluer l'association entre le statut HPV et les facteurs de risque cliniques sélectionnés chez les patients atteints de CEÉ. La consommation de boissons chaudes a été incluse dans le modèle univarié en raison de sa pertinence exploratoire, mais a été exclue du modèle de régression logistique de Firth pour minimiser l'instabilité du modèle compte tenu de la petite taille de l'échantillon et de la variabilité limitée des données. Les résultats étaient cohérents entre les modèles : le groupe d'âge, la consommation d'alcool et le tabagisme n'étaient pas significativement associés au statut HPV (tous p > 0,05) (Tableau 5).
Tableau 5. Résultats de la régression logistique non ajustée et ajustée pour les facteurs associés au statut HPV chez les patients atteints de CEÉ.
L’analyse de régression logistique univariée a identifié plusieurs facteurs significativement associés au statut VIH (Tableau 6). L’analyse par groupe d’âge (≤50 vs. >50) a révélé une association significative (OR = 6,88, p = 0,020), indiquant que les patients atteints de CEÉ de moins de 50 ans sont plus susceptibles d’être séropositifs que ceux de plus de 50 ans. La consommation d’alcool (OR = 3,30, p = 0,013) et le tabagisme (OR = 4,23, p = 0,003) étaient également significativement associés au statut VIH. De même, la positivité au HPV18 était significativement associée au statut VIH (OR = 6,67, p = 0,005), indiquant une probabilité plus élevée d’infection par le VIH chez les patients atteints de CEÉ avec HPV18. En outre, la consommation combinée d’alcool et de tabac (OR = 3,19, p = 0,020) était significativement associée au statut VIH, suggérant que les patients atteints de CEÉ qui consomment à la fois de l’alcool et du tabac ont une probabilité accrue d’être séropositifs. En revanche, le HPV16 et la consommation de boissons chaudes n’étaient pas significativement associés au statut VIH (p > 0,05). Nous avons ensuite ajusté deux modèles de régression logistique de Firth multivariés : un modèle complet incluant tous les prédicteurs pertinents et un modèle parcimonieux avec quatre variables clés (âge, alcool, tabagisme et statut HPV18). Dans le modèle complet, aucune des associations n’est restée statistiquement significative après ajustement (p > 0,05), bien que l’effet de la positivité au HPV18 ait montré une tendance potentielle (OR ajusté = 3,32, IC à 95 % : 0,79 – 13,93 ; p = 0,101).
Tableau 6. Résultats de la régression logistique non ajustée et ajustée pour les facteurs associés au statut VIH chez les patients atteints de CEÉ.
Dans le modèle parcimonieux, la positivité au HPV18 est restée à la limite de la signification (OR ajusté = 4,17, IC à 95 % : 1,00–16,97 ; p = 0,050). L’âge, l’alcool et le tabagisme ont montré des tendances non significatives dans le modèle ajusté.
Aucun des patients de notre cohorte n’avait d’antécédents d’achalasie ou de lésion caustique. Le régime alimentaire de base le plus courant était à base de maïs, la majorité des patients déclarant consommer régulièrement des légumes. La consommation de boissons chaudes a été rapportée par 72 % (n=56) des patients, tous buvant du thé ou du café à haute température, le thé étant la boisson la plus consommée. Cependant, aucune association statistiquement significative n’a été trouvée entre la consommation de boissons chaudes et les infections virales dans notre cohorte. Seuls neuf patients ont rapporté des antécédents familiaux de cancer, dont cinq avaient des cancers gastro-intestinaux supérieurs suspectés. Cependant, le diagnostic précis était inconnu dans la plupart des cas, sauf pour un patient qui a confirmé un parent au premier degré atteint de cancer de l’œsophage. Parmi les comorbidités, l’hypertension était la plus fréquente, diagnostiquée chez 16 patients (20,5 %), suivie du diabète sucré chez cinq patients. Seuls deux patients avaient à la fois de l’hypertension et du diabète. Une analyse du chi carré a révélé une association significative entre le tabagisme et la consommation d’alcool chez les patients atteints de CEÉ (p < 0,001) ; 88 % des patients qui ont déclaré fumer ont également déclaré consommer de l'alcool, contre seulement 13 % parmi ceux qui ne fument pas. Le carcinome œsophagien est l'un des cancers les plus difficiles à affronter à l'échelle mondiale, principalement en raison du mauvais pronostic associé à une présentation clinique à un stade avancé de la maladie, qui est malheureusement le stade typique de présentation pour la grande majorité des patients. L'Afrique du Sud non seulement supporte un fardeau considérable de ce cancer, mais supporte également un énorme fardeau de virus cancérigènes tels que le VIH et le HPV. La recherche a démontré que certaines infections virales peuvent avoir une influence sur le développement et la progression du CEÉ. Par exemple, le HPV a été identifié comme un agent causal potentiel, et les personnes vivant avec le VIH ont été signalées comme ayant une incidence plus élevée de CEÉ par rapport aux patients sans VIH. Le HPV, qui a été identifié comme le virus sexuellement transmissible le plus fréquent dans le monde, a été reconnu comme un agent étiologique clé dans les malignités provenant de l'épithélium squameux, comme dans les régions cervicales, anogénitales et oropharyngées. Des études antérieures ont montré qu'environ 25 % des cancers de la tête et du cou sont causés par le HPV et peuvent être directement liés à l'exposition au sexe oral. Les types de HPV les plus couramment identifiés et signalés liés aux carcinomes sont les souches à haut risque HPV-16 et HPV-18. Ces deux souches ont été reconnues comme des agents cancérigènes de catégorie 1 chez l'homme. Elles sont également les deux souches de HPV les plus souvent signalées en relation avec les malignités du tractus aérodigestif supérieur. Elles étaient les deux souches de HPV à haut risque les plus couramment observées liées au CEÉ, au cancer du col de l'utérus et aux cancers épidermoïdes oropharyngés dans des études antérieures. Dans cette étude, nous avons constaté que l'infection par le HPV était courante, avec 56,4 % de notre population atteinte de CEÉ testée positive. De plus, conformément aux recherches antérieures, nous avons découvert que le HPV 16 et le HPV 18 étaient les deux souches les plus couramment observées. Nous avons trouvé que le HPV 16 était le plus courant, affectant 68,2 % des patients positifs au HPV, et le HPV 18 était présent chez 40,9 % des positifs au HPV. Il est notable de mentionner que des études antérieures évaluant la prévalence du HPV dans le cancer de l'œsophage ont détecté des taux de prévalence beaucoup plus élevés et une gamme plus large de souches de HPV à partir de leurs tumeurs ; par exemple, une étude antérieure de Pretoria a trouvé une infection par le HPV chez 90 % des patients atteints de CEÉ, et a identifié les génotypes les plus courants comme étant le HPV 51 (62,0 %), le HPV 70 (48,0 %), avec le HPV-16 en troisième position à 44,0 % suivi par le HPV 82 à 34,0 %. Une revue systémique par Ludmir et al. a trouvé que le taux d'infection par le HPV dans le CEÉ présentait une variation géographique notable qui corrélait avec la prévalence du CEÉ. Les régions avec des taux d'incidence plus élevés de CEÉ montraient des taux d'infection par le HPV plus élevés. Cependant, la revue n'a pas démontré un rôle oncogène significatif du HPV dans le CEÉ. Une autre revue systémique a également démontré une variation géographique et interrégionale significative dans la détection de l'infection par le HPV dans le CEÉ. Par exemple, une étude australienne a détecté le HPV dans seulement 8/222 (3,6 %) de blocs FFPE archivés de CEÉ (avec la souche la plus courante étant le HPV 16 suivi par le HPV 35) ; tandis qu'une autre étude d'Afrique de l'Est a détecté le HPV dans 63/118 (53,3 %) de leurs blocs FFPE de CEÉ (également le HPV 16 était le plus prévalent). L'Afrique du Sud montre également des variations géographiques notables dans les taux d'incidence du CEÉ, les provinces orientales (c'est-à-dire, le Kwazulu-Natal et le Cap oriental) présentant des taux d'incidence significativement plus élevés par rapport aux autres provinces. Par exemple, cette étude a été réalisée dans la région du highveld central et n'a identifié que 78 patients sur une période de 36 mois, tandis qu'une autre étude au KwaZulu-Natal a rapporté sur 159 patients vus sur une période de 15 mois, équivalant à environ deux fois nos chiffres en moins de la moitié du temps. Une autre étude menée dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud a montré une faible incidence de CEÉ, ne détectant que 114 patients sur une période de 4 ans, et de plus, l'étude a trouvé que seulement 9 % de cette cohorte était infectée par le HPV, avec le HPV 18 étant la souche la plus courante. Comme mentionné précédemment, une étude de Pretoria a détecté le HPV chez 90 % de leurs patients. L'enquête actuelle a découvert que 56,4 % des patients atteints de CEÉ étaient infectés par le HPV. Cependant, la nature ciblée du génotypage du HPV utilisé dans notre enquête peut également impliquer que d'autres souches à haut risque (telles que le HPV 35, le HPV 51 et le HPV 82) qui ont été trouvées dans des études antérieures étaient présentes mais n'ont pas été testées, influençant ainsi le taux de prévalence observé. L'Afrique du Sud est confrontée à un taux élevé d'infections par le VIH. Le VIH lui-même a été lié à un risque accru de CEÉ. Une grande étude rétrospective qui a comparé les taux de prévalence du cancer de l'œsophage et de l'estomac entre 44 075 hommes infectés par le VIH et une cohorte appariée non infectée par le VIH a trouvé que le taux de CEÉ était plus de 2 fois plus élevé chez les patients atteints de cancer infectés par le VIH par rapport aux individus non infectés par le VIH, avec des taux d'incidence de 9,12 pour 100 000 personnes-années contre 4,20 pour 100 000 personnes-années, respectivement, ce qui se traduit par un risque environ 58 % plus élevé de CEÉ dans le groupe infecté par le VIH. En outre, il a été démontré que le VIH augmente l'acquisition et la progression des maladies liées au HPV, y compris les cancers induits par le HPV. Par exemple, les femmes vivant avec le VIH qui ont une infection persistante par le HPV ont montré un risque six fois plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus par rapport à celles sans VIH en raison de l'immunosuppression induite par le VIH. Des chercheurs précédents ont rapporté que la muqueuse buccale des individus séropositifs avait une prévalence plus prononcée de souches de HPV à haut risque par rapport aux individus séronégatifs, les individus infectés par le VIH présentant un taux de prévalence de HPV oral 2 à 3 fois plus élevé par rapport aux personnes non infectées par le VIH. De plus, par rapport au grand public, les PLWHIV ont été trouvés plus susceptibles de développer des malignités associées au HPV. Cette étude n'a pas trouvé de corrélation statistiquement significative entre le VIH et le HPV dans la cohorte globale de CEÉ (valeur p = 0,78). En fait, le taux d'infection par le VIH était légèrement plus élevé chez les patients qui n'avaient pas de HPV que chez ceux qui en avaient, à 44 % contre 41 %, respectivement. De plus, 67 % des individus séropositifs co-infectés par le HPV avaient la souche HPV-18, révélant une association à la limite entre le VIH et le HPV-18 (avec une valeur p brute χ² = 0,015 et une valeur p ajustée BH = 0,051). Cependant, en raison de la petite taille de l'échantillon et de l'absence de groupe témoin non cancéreux, la signification du HPV 18 chez les patients séropositifs nécessite une évaluation plus approfondie dans des études plus larges pour une interprétation adéquate. Plusieurs facteurs de risque sont associés au CEÉ, y compris la consommation d'alcool et le tabagisme. Dans une méta-analyse récente évaluant les facteurs de risque de CEÉ dans le corridor africain du CEÉ, le tabagisme et l'alcool ont été identifiés comme des facteurs de risque significatifs. Le pourcentage de CEÉ attribuable à l'utilisation du tabac était de 18 %, tandis que le pourcentage attribuable à l'utilisation de l'alcool était de 12 %, et le pourcentage attribuable à l'utilisation combinée du tabac et de l'alcool était de 18 %. De plus, par rapport aux individus séronégatifs, les individus séropositifs ont été trouvés plus susceptibles de s'engager dans des comportements à haut risque, tels que la consommation d'alcool, le tabagisme ainsi que des comportements sexuels à risque. Dans cette étude actuelle, la régression logistique univariée a suggéré que les patients séropositifs étaient plus susceptibles de fumer et de boire de l'alcool par rapport aux patients séronégatifs ; avec le tabagisme rapporté par 61 % contre 32 % et l'utilisation d'alcool par 61 % contre 27 %, à p = 0,012 et p = 0,003, respectivement. L'utilisation combinée d'alcool et de tabac a également été trouvée plus fréquemment chez les individus séropositifs (52 % contre 25 %) avec p = 0,017. Une proportion significative de patients atteints de CEÉ ont rapporté l'utilisation de tabac et d'alcool, soit seuls, soit en combinaison, indépendamment de leur statut viral (p < 0,001), avec 88 % des personnes qui fument déclarant utiliser régulièrement de l'alcool. Cependant, lorsque la régression logistique multivariée et l'ajustement de la procédure BH (p>0,05) ont été réalisés, seul le tabagisme est resté statistiquement significativement associé au VIH (p = 0,045). Par conséquent, notre étude démontre un lien entre l’infection par le VIH et le tabagisme dans le CEÉ. L’analyse de régression logistique univariée et de Firth évaluant les associations entre le HPV et les facteurs démographiques, de mode de vie et de risque, n’a trouvé aucune association statistiquement significative entre le statut HPV et le sexe, le groupe d’âge, la race, le régime alimentaire de base, la consommation de légumes, la consommation de boissons chaudes, la présence de comorbidités, les antécédents familiaux de cancer, la consommation d’alcool, le tabagisme ou l’utilisation combinée d’alcool et de tabac. Il semble que davantage de recherches soient encore nécessaires pour déterminer le taux d’incidence et l’influence des infections par le HPV dans le CEÉ en Afrique du Sud.
Concernant l’âge et le VIH, une étude antérieure menée en Afrique du Sud a découvert que les patients séropositifs étaient 10 ans plus jeunes que la population générale lorsqu’ils ont été diagnostiqués avec un CEÉ. De même, la régression logistique univariée dans l’étude actuelle a montré que les patients atteints de CEÉ de moins de 50 ans étaient plus susceptibles d’être séropositifs que ceux de plus de 50 ans avec p = 0,02. De nombreuses études ont lié la consommation de boissons chaudes à l’étiologie du CEÉ, le mécanisme supposé étant la blessure thermique récurrente à la muqueuse de l’œsophage. Notre étude a démontré que la consommation de boissons chaudes était courante dans notre population, étant rapportée par 72 % (n=56) de notre groupe de patients. Presque tous ont caractérisé leurs boissons comme chaudes lors de la consommation et le nombre de tasses bues par jour variait entre 2 et 4. Néanmoins, notre étude n’a montré aucune association statistiquement significative entre la consommation de boissons chaudes et les infections virales dans le CEÉ.
Notre étude présente plusieurs limitations, notamment une petite taille d’échantillon (n=78), et le fait qu’elle a été menée dans un seul centre tertiaire. La petite taille de l’échantillon limite la capacité à extrapoler avec confiance les résultats de l’étude, tandis que l’accent mis sur un seul centre implique que nos résultats doivent être traités avec prudence jusqu’à une validation externe supplémentaire à partir d’études multicentriques. Une autre limitation est l’absence de données cliniques supplémentaires sur la gravité de la maladie VIH, telles que les charges virales, les comptes de CD4 et la durée de l’ART, qui n’ont pas été mesurées dans cette étude, par conséquent l’influence de la latence virale et de la persistance sur le CEÉ ne peut pas être évaluée de manière adéquate.
Un biais de référence peut avoir eu lieu dans cette étude en raison de cas plus avancés étant référés au SBAH, ce qui pourrait gonfler la prévalence observée des co-infections par le VIH et le HPV. Ce biais peut ne pas représenter avec précision la situation dans le Gauteng. De plus, un biais de sélection peut se produire si les individus vivant avec le VIH sont plus susceptibles de consentir à participer à l’étude. Étant donné que les populations de soins tertiaires urbains présentent souvent une prévalence du VIH plus élevée que les moyennes nationales, les résultats de telles cohortes peuvent ne pas être généralisables. Ces biais soulignent la nécessité d’une interprétation prudente des estimations de prévalence et des associations de facteurs de risque dans les études menées dans des environnements de soins de santé spécialisés.
En outre, il est probable que le nombre total de positifs au HPV ait été réduit en se concentrant sur les souches de HPV à haut risque les plus couramment signalées (HPV 16 et 18), plutôt qu’en utilisant des tests qui ont testé une variété beaucoup plus large de souches de HPV. L’utilisation de « kits à large filet » aurait probablement donné un plus grand nombre de patients positifs au HPV. L’absence de détection d’autres types oncogènes de HPV peut ne pas fournir une compréhension complète de la contribution virale au fardeau de la maladie. Néanmoins, la pertinence clinique des autres souches devrait encore être déterminée. Troisièmement, notre étude a analysé des échantillons FFPE acquis à partir de biopsies endoscopiques microscopiques, qui ont des limites en ce qui concerne la quantité de tissus disponibles (c’est-à-dire, par rapport aux spécimens de résection). En plus de cela, l’utilisation d’échantillons FFPE peut réduire la sensibilité de la PCR en raison de la fragmentation de l’ADN et de la modification chimique, des facteurs connus pour compromettre l’intégrité des acides nucléiques. Cela peut se produire malgré l’utilisation de protocoles d’extraction optimisés et de kits FFPE dédiés. En tant que tels, les échantillons de tissus frais congelés seraient la source d’échantillons la plus souhaitable pour les études futures.
Notre enquête n’a pas pu démontrer une association statistiquement significative entre le HPV et le VIH chez les patients atteints de carcinome épidermoïde de l’œsophage au SBAH et les résultats montrent que le statut VIH n’a peut-être pas influencé le taux de positivité au HPV entre les années d’étude, cependant l’étude n’était pas suffisamment puissante pour détecter une telle association, si elle existait. La souche HPV 18 a montré une légère tendance à la prédominance dans les tumeurs œsophagiennes chez les personnes séropositives également infectées par le HPV.
Des études multicentriques plus larges sont nécessaires pour évaluer la co-infection par le VIH et le HPV dans le CEÉ, en particulier dans les régions à haut risque. Idéalement, ces enquêtes devraient être menées sur des échantillons de tissus frais qui ont été correctement conservés plutôt que d’utiliser des tissus FFPE. Le statut HPV des tissus normaux adjacents à la tumeur, ainsi que les profils d’expression épigénétique de la tumeur et des tissus normaux adjacents, devraient être évalués. Des recherches supplémentaires sur la signification et la tendance potentielle du HPV 18 chez les patients séropositifs étant associés au CEÉ, y compris le mécanisme biologique, la synergie oncogène potentielle sous-jacente entre l’infection par le VIH et le HPV dans la carcinogenèse œsophagienne doit être entreprise. Cela offrirait des informations précieuses sur la dynamique de la co-infection et la susceptibilité au cancer dans les populations immunodéprimées. Cela nécessiterait également une portée élargie du génotypage du HPV pour établir pleinement l’implication du HPV. Les études futures pourraient également identifier des altérations moléculaires au-delà de la détection virale.
Les contributions originales présentées dans l’étude sont incluses dans l’article/matériel supplémentaire. Pour toute question complémentaire, veuillez contacter les auteurs correspondants.
L’approbation éthique a été obtenue du Comité d’éthique de la recherche de l’Université de Pretoria (Numéro d’étude : 296/2021) et du Département de la santé du Gauteng (Réf. NHRD n° : GP_202107_062). Les études ont été menées conformément à la législation locale et aux exigences institutionnelles. Les participants ont fourni leur consentement éclairé écrit pour participer à cette étude.
SM : Rédaction – révision et édition, Curation des données, Investigation, Conceptualisation, Méthodologie, Rédaction – brouillon original, Acquisition de financement, Administration de projet, Analyse formelle. TM : Rédaction – révision et édition, Investigation, Méthodologie. DR : Méthodologie, Rédaction – révision et édition, Investigation. BD : Rédaction – révision et édition, Méthodologie, Investigation. PN : Analyse formelle, Rédaction – révision et édition. MM : Investigation, Rédaction – révision et édition, Méthodologie. BM : Rédaction – révision et édition, Investigation, Curation des données. RH : Rédaction – révision et édition, Visualisation. ZD : Conceptualisation, Supervision, Rédaction – révision et édition, Rédaction – brouillon original.
Les auteurs déclarent avoir reçu un soutien financier pour la recherche et/ou la publication de cet article. Cette recherche a été financée par la National Research Foundation (NRF) – subvention Thuthuka TTK2204123158 et le Discovery Foundation Academic Fellowship Award Réf. Numéro : 045460. Ce projet a également été rendu possible par le South African Medical Research Council (SAMRC), Numéro de subvention 23108, et la National Research Foundation (NRF), Numéro de subvention 138139.
Les auteurs déclarent que la recherche a été menée en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un conflit d’intérêt potentiel.
Les auteurs déclarent qu’aucune IA générative n’a été utilisée dans la création de ce manuscrit.
Tout texte alternatif (alt text) fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers avec le soutien de l’intelligence artificielle et des efforts raisonnables ont été faits pour assurer l’exactitude, y compris une révision par les auteurs dans la mesure du possible. Si vous identifiez des problèmes, veuillez contacter nous.
Toutes les affirmations exprimées dans cet article sont uniquement celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de leurs organisations affiliées, ou celles de l’éditeur, des éditeurs et des réviseurs. Tout produit qui pourrait être évalué dans cet article ou toute affirmation qui pourrait être faite par son fabricant n’est pas garanti ou approuvé par l’éditeur.
🔗 **Fuente:** https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2025.1634565/full