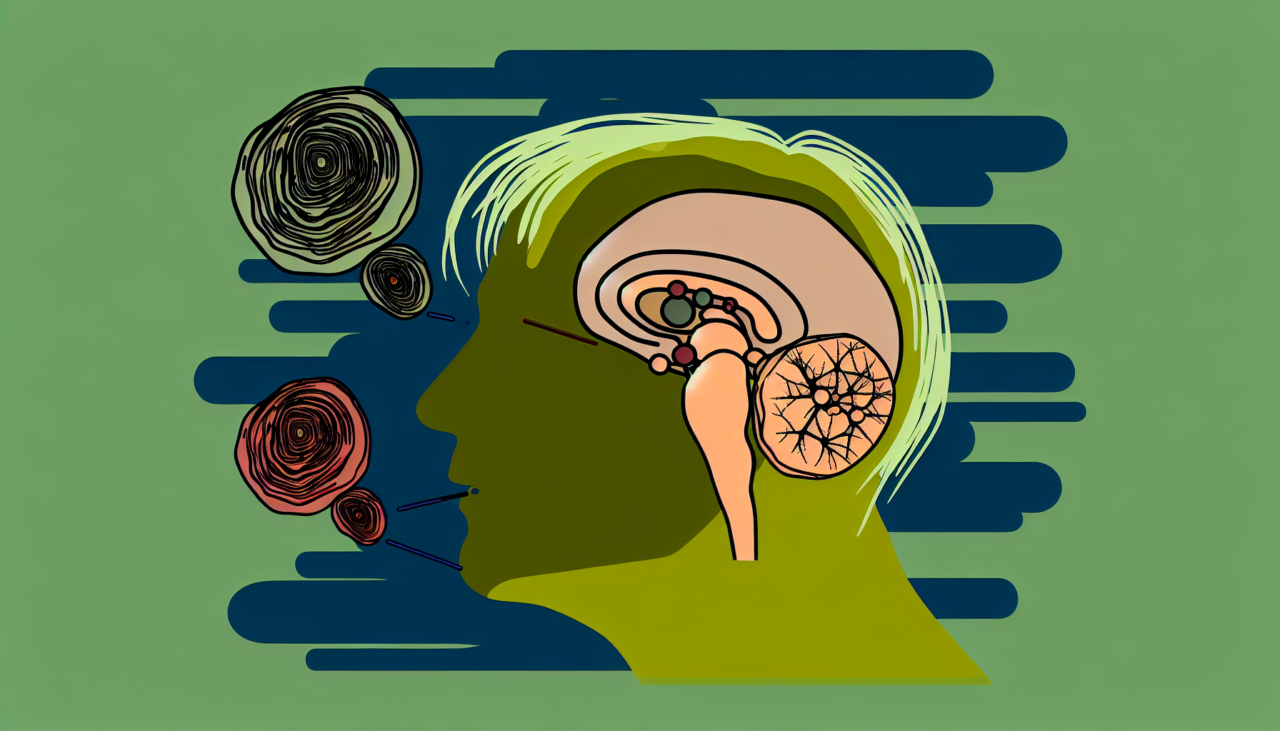Introduction
La perte auditive liée à l’âge (ARHL) est une déficience sensorielle courante chez les adultes âgés et est considérée comme un facteur de risque pour le développement de la démence. Des recherches antérieures ont montré des altérations de la topologie du connectome cérébral dans l’ARHL, y compris une force nodale anormale et un coefficient de regroupement. Cependant, il reste inconnu si l’ARHL affecte l’organisation hiérarchique du connectome structurel et comment ces altérations se rapportent aux signatures transcriptomiques.
Méthodologie
Dans cette étude, nous appliquons un cadre de cartographie de gradient au connectome structurel dérivé de l’imagerie par résonance magnétique de diffusion. Nous nous concentrons sur les trois premiers gradients structurels qui reflètent l’organisation hiérarchique distincte du connectome structurel et évaluons les changements liés à l’ARHL.
Résultats
Nous avons constaté que, par rapport aux témoins, les patients atteints d’ARHL présentent des perturbations généralisées de l’organisation du connectome structurel, s’étendant des zones sensorielles primaires (par exemple, le réseau somatomoteur) aux zones d’association de haut niveau (par exemple, le réseau en mode par défaut). En utilisant des gradients pondérés sous-corticaux dérivés de la pondération des gradients corticaux par la connectivité sous-corticale-corticale, nous observons que les patients atteints d’ARHL montrent une connectivité sous-corticale-corticale significativement altérée dans le caudé gauche, le noyau accumbens gauche, l’hippocampe droit et l’amygdale droite. Enfin, nous examinons la relation entre l’expression génique et les altérations des gradients structurels. Nous observons que ces altérations sont associées à des profils d’expression génique pondérés, avec des gènes pertinents enrichis de manière préférentielle pour le transport transmembranaire d’ions inorganiques et des termes liés à la régulation des processus biologiques.
Discussion
Ensemble, ces résultats soulignent que l’ARHL est associée à une hiérarchie anormale du connectome structurel et révèlent la pertinence transcriptomique de ces anomalies, contribuant à une compréhension plus riche des substrats neurobiologiques dans l’ARHL.
La perte auditive liée à l’âge (ARHL) est une déficience sensorielle répandue qui affecte plus de 40 % des adultes de plus de 50 ans, entraînant un isolement social, des difficultés de communication et une diminution de la qualité de vie. Les individus atteints d’ARHL sont considérés comme ayant un risque accru de déficits cognitifs et de démence. Des études de neuroimagerie antérieures ont démontré que les patients atteints d’ARHL présentent des réseaux cérébraux perturbés dans les caractéristiques locales et globales. Par exemple, par rapport aux témoins sains, les patients atteints d’ARHL ont montré une augmentation significative de l’efficacité globale et du coefficient de regroupement des réseaux fonctionnels, ainsi que des changements dans la force nodale locale des réseaux structurels dans plusieurs régions. À travers l’analyse du connectome cérébral et la théorie des graphes, ces études fournissent des informations précieuses sur les mécanismes neuropathologiques sous-jacents à l’ARHL.
En compressant les connectomiques cérébrales à grande échelle dans un espace d’intégration de faible dimension, la technique de cartographie de gradient récemment développée offre un cadre attrayant pour élucider les principes organisationnels systématiques du connectome cérébral. Différente de la théorie des graphes qui caractérise les propriétés topologiques locales et globales des réseaux, cette technique génère une série d’arrangements spatiaux (appelés gradients) qui capturent les variations continues des profils de connectivité, avec des régions étroitement interconnectées positionnées de manière proximale le long des axes de gradient. La variation spatiale du gradient informe sur la manière dont les profils de connectivité des régions distribuées sont intégrés et séparés. Par exemple, le gradient principal dérivé de la connectivité fonctionnelle en état de repos représente une organisation à grande échelle qui différencie les zones transmodales en mode par défaut et les zones sensorielles unimodales. Un corpus substantiel de recherches a utilisé la cartographie de gradient pour caractériser les altérations des caractéristiques organisationnelles de la connectivité fonctionnelle et structurelle au cours du développement et du vieillissement, ainsi que des troubles neuropsychiatriques. Spécialement, une étude récente a rapporté que les patients atteints d’ARHL présentaient des altérations du gradient principal de la connectivité fonctionnelle dans les réseaux visuel et en mode par défaut, suggérant une organisation fonctionnelle anormale. Néanmoins, il reste incertain si les organisations hiérarchiques de la connectivité structurelle sont également altérées chez les patients atteints d’ARHL. De plus, des preuves préliminaires indiquent que l’ARHL est associée à des changements dans les structures sous-corticales, mais il existe peu d’études examinant la connectivité structurelle sous-corticale-corticale chez les patients atteints d’ARHL. Il reste incertain si les altérations des gradients structurels s’accompagnent d’altérations sous-corticales. Étant donné la relation potentielle entre les connectomes fonctionnels et structurels, l’identification de la hiérarchie du connectome structurel altéré fournit des informations précieuses sur les anomalies du réseau fonctionnel observées dans l’ARHL.
La disponibilité de cartes transcriptomiques cérébrales complètes, telles que l’Atlas du cerveau humain d’Allen (AHBA), a offert des opportunités d’évaluer les relations entre l’expression génique et les phénotypes de neuroimagerie. Des études antérieures ont exploré la correspondance spatiale entre les profils d’expression génique et les variations régionales des phénotypes de neuroimagerie, donnant des informations sur les substrats moléculaires potentiels qui sous-tendent les phénotypes altérés. Par exemple, les anomalies dans l’organisation du connectome fonctionnel ou structurel ont été associées à des schémas d’expression génique dans plusieurs troubles cérébraux, y compris l’autisme, la dépression et la maladie d’Alzheimer. Cependant, il reste incertain si et comment les altérations de l’organisation du connectome structurel dans l’ARHL se rapportent à l’expression génique.
Ici, nous avons cherché à savoir si les organisations hiérarchiques du connectome structurel sont altérées chez les patients atteints d’ARHL, et si oui, fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes moléculaires potentiels sous-jacents à ces changements. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode de cartographie de diffusion pour estimer les trois premiers gradients structurels chez les témoins et les patients. Nous avons émis l’hypothèse que les patients atteints d’ARHL montreraient des gradients structurels significativement différents par rapport aux témoins. Ensuite, nous avons utilisé des gradients pondérés sous-corticaux pour examiner si les patients atteints d’ARHL étaient associés à une connectivité structurelle sous-corticale-corticale anormale. Enfin, nous avons appliqué une régression par moindres carrés partiels (PLS) pour étudier la relation entre les altérations des gradients structurels et les données transcriptomiques.
Le jeu de données est obtenu à partir du Connectome de la perte auditive (ds005026) disponible sur la plateforme OpenNeuro. Cinquante-deux patients atteints d’ARHL (16 femmes; 63,67 ± 7,80 ans) et trente témoins normo-entendants (20 femmes; 59,53 ± 7,17 ans) ont été inclus. Tous les participants n’avaient pas d’antécédents de maladie neurologique et/ou psychiatrique, de chirurgie de l’oreille ou de contre-indications spécifiques à la résonance magnétique. L’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale ont été réalisées pour évaluer l’état audiologique des participants. Plus de détails sur l’évaluation auditive peuvent être trouvés dans Ponticorvo et al. Tous les participants ont fourni un consentement éclairé écrit, et les procédures expérimentales ont été approuvées par le comité d’éthique institutionnel de l’Université de Salerne.
Les données IRM ont été collectées sur un scanner Siemens Skyra 3T avec une bobine RF tête-et-cou à 20 canaux. Les images pondérées T1 ont été acquises avec une séquence MPRAGE utilisant les paramètres suivants : TR = 2,4 s, TE = 2,26 ms, TI = 0,95 s, angle de basculement = 8°, matrice = 256 × 256, taille de voxel = 1 × 1 × 1. Les images pondérées par diffusion ont été collectées avec une séquence écho-planar accélérée par multi-bande utilisant les paramètres suivants : TR = 4,71 s, TE = 0,0906 s, Facteur d’accélération = 2, angle de basculement = 90°, taille de voxel = 2 × 2 × 2, 1 volume avec b = 0 s/mm2, 64 directions non collinéaires avec b = 1500 s/mm2. Un scan pondéré par diffusion avec des directions de codage de phase opposées a été acquis pour corriger les distorsions de susceptibilité.
Toutes les images pondérées T1 ont été soumises à une segmentation tissulaire et à une reconstruction de la surface corticale par le pipeline recon-all de FreeSurfer (version : 7.4.1). Les données pondérées par diffusion ont été traitées en utilisant FSL (version : 6.0.7), MRtrix3 (version : 3.0.4), et MRtrix3Tissue (version : 5.2.9). Les procédures de prétraitement comprenaient la réduction du bruit, la correction des distorsions de susceptibilité, les corrections des mouvements et des distorsions de courant de Foucault, la correction du champ de biais et l’estimation du masque cérébral. Le connectome structurel individuel a été dérivé des données de diffusion prétraitées. Nous avons estimé les fonctions de réponse des différents tissus en utilisant l’algorithme de Dhollander. Les distributions d’orientation des fibres ont été reconstruites en utilisant la méthode de déconvolution sphérique contrainte à trois tissus à coquille unique et ont été normalisées en intensité dans le domaine logarithmique. Une tractographie de l’ensemble du cerveau avec 5 millions de lignes de flux a été générée en utilisant une approche probabiliste (iFOD2) et un algorithme de tractographie anatomiquement contraint (ACT) avec un semis dynamique, et l’estimation des poids des tractus (SIFT2) pour réduire les biais de reconstruction. La parcellisation Schaefer-400 a été mappée sur l’espace pondéré par diffusion individuel pour créer une connectivité structurelle corticale. Huit structures sous-corticales bilatérales (y compris le thalamus, le caudé, le putamen, le pallidum, l’hippocampe, l’amygdale, l’accumbens et le diencéphale ventral) dérivées de la segmentation de FreeSurfer ont été utilisées pour construire la connectivité sous-corticale-corticale. La connectivité structurelle entre les paires de régions a été davantage mise à l’échelle par l’inverse des volumes de deux régions. Le contrôle de qualité des images pondérées T1 a été effectué par inspection visuelle, et deux participants avec des mouvements excessifs de la tête ou une mauvaise segmentation corticale ont été exclus. Les données de diffusion de deux participants avec des valeurs aberrantes totales élevées ont été exclues. De plus, les données de diffusion d’un participant avaient une direction de codage de phase différente de celle des autres participants et ont également été exclues de cette étude. Enfin, 77 participants (49 patients) ont été retenus pour l’analyse ultérieure.
Pour chaque participant, nous avons estimé les gradients du connectome structurel en utilisant la boîte à outils BrainSpace. Plus précisément, nous avons construit une matrice d’affinité en calculant la similarité cosinus entre les profils de connectivité structurelle régionale. En raison de la rareté du connectome structurel, cette étape a été mise en œuvre sur le connectome structurel individuel qui n’a pas été sevré. Nous avons ensuite effectué une intégration de carte de diffusion non linéaire de la matrice d’affinité pour obtenir plusieurs composants continus (c’est-à-dire des gradients structurels) qui ont été arrangés dans un ordre décroissant de variance expliquée. La procédure traite la matrice d’affinité comme un graphe et estime l’intégration de faible dimension à partir de la matrice de connectivité de haute dimension. Le long des axes de faible dimension, les régions qui sont étroitement interconnectées sont plus proches les unes des autres, tandis que les régions avec une interconnexion faible sont plus éloignées. L’intégration de carte de diffusion a été affectée par deux paramètres t et α. Conformément aux études précédentes, nous avons fixé t = 0 et α = 0,5 pour préserver les relations globales entre les points dans l’espace intégré. Pour assurer la comparabilité entre les gradients structurels des participants, nous avons construit un modèle de gradient au niveau du groupe. Conformément aux études antérieures, nous avons moyenné toutes les matrices de connectome structurel des patients et des témoins pour générer le connectome structurel au niveau du groupe. Nous avons estimé le modèle de gradient au niveau du groupe à partir du connectome structurel au niveau du groupe et aligné les gradients structurels de chaque participant sur le modèle via un alignement de Procrustes. L’alignement de Procrustes a été largement utilisé pour faire pivoter les gradients au niveau individuel afin d’obtenir une similarité maximale avec les gradients modèles, sans appliquer de facteur d’échelle. L’alignement de Procrustes détermine une transformation linéaire optimale S entre les gradients non alignés G et les gradients modèles M, qui minimise la somme des erreurs quadratiques entre les gradients alignés (G*S) et les gradients modèles M. En d’autres termes, le gradient aligné est obtenu par une combinaison linéaire des gradients non alignés.
Conformément aux travaux antérieurs, nous avons appliqué des analyses multivariées pour comparer les différences dans les trois premiers gradients structurels entre les patients atteints d’ARHL et les témoins. Dans les analyses multivariées, nous avons utilisé le T de Hotelling pour identifier les effets partagés de l’ARHL à travers les trois gradients structurels. Nous avons effectué des comparaisons entre les groupes au niveau du réseau et au niveau régional. Plus précisément, pour les analyses au niveau du réseau, nous avons moyenné les scores de gradient régionaux selon les sept systèmes fonctionnels de Yeo, qui comprenaient les réseaux visuel, somatomoteur, d’attention dorsale, d’attention ventrale, limbique, frontopariétal et en mode par défaut. Nous avons utilisé des analyses multivariées pour comparer les différences au niveau du réseau à travers les trois premiers gradients structurels, avec une signification statistique fixée à p < 0,05 corrigé par FDR. Nous avons ensuite effectué des comparaisons de gradient unique sur chaque gradient séparément, en utilisant le modèle linéaire univarié. Les comparaisons multiples ont été corrigées par la méthode FDR (p corrigé < 0,05). Pour les analyses au niveau régional, nous avons effectué des analyses multivariées pour évaluer les différences entre les groupes dans les scores de gradient de chaque région à travers les trois premiers gradients structurels, avec une signification statistique fixée à p < 0,05 corrigé par FDR. Nous avons ensuite effectué des analyses post-hoc pour examiner les contributions de chaque gradient aux effets globaux, tout en corrigeant pour le nombre de gradients structurels considérés (p < 0,05/3). Nous avons également effectué des comparaisons régionales sur chaque gradient en utilisant le modèle linéaire univarié, avec une signification statistique fixée à p < 0,05 corrigé par FDR. Dans toutes les comparaisons, l'âge et le sexe ont été inclus comme covariables. Toutes les analyses multivariées ont été effectuées en utilisant la boîte à outils BrainStat. Les visualisations de surface des différences entre les groupes dans les gradients structurels ont été générées en utilisant les packages Python BrainSpace et Surfplot. Pour comprendre l'implication cognitive des régions cérébrales avec des altérations significatives liées à l'ARHL, nous avons effectué un décodage fonctionnel méta-analytique en utilisant le package Python NiMARE. Nous n'avons conservé que les régions corticales significatives pour obtenir une carte T de Hotelling sevrée. Le processus de décodage a corrélé la carte sevrée avec toutes les cartes méta-analytiques dans la base de données NeuroSynth. Nous n'avons conservé que les 15 termes les plus pertinents pour les comportements ou fonctions cognitives. Nous avons capitalisé sur le gradient pondéré sous-cortical pour évaluer les altérations liées à l'ARHL dans la connectivité sous-corticale-corticale. Conformément aux études précédentes, le gradient pondéré sous-cortical pour chaque région sous-corticale a été généré par une multiplication élément par élément entre le gradient structurel et la connectivité structurelle sous-corticale-corticale. Nous avons ensuite moyenné chaque gradient pondéré sous-cortical pour extraire les valeurs de degré nodal. Des analyses multivariées ont été mises en œuvre pour comparer les différences entre les groupes dans les valeurs de degré nodal le long des trois premiers gradients, avec l'âge et le sexe comme covariables. Nous avons ensuite utilisé le modèle linéaire univarié pour évaluer les différences dans les valeurs de degré correspondant à chaque gradient pondéré sous-cortical. Les comparaisons multiples ont été ajustées par la méthode FDR (p corrigé < 0,05). Les visualisations sous-corticales des différences entre les groupes dans les gradients pondérés sous-corticaux ont été basées sur les packages R ggplot2 et ggseg. Nous avons utilisé les données transcriptomiques de la base de données AHBA pour examiner la relation entre les différences entre les groupes dans les gradients structurels et les profils d'expression génique. La base de données AHBA contenait des données de microarray post-mortem dans 3 702 échantillons de tissus cérébraux différents de six donneurs neurotypiques. Étant donné que ces données de microarray post-mortem de la base de données AHBA sont le seul atlas d'expression génique à haute résolution spatiale disponible publiquement, c'est un choix de compromis pour analyser l'association transcriptionnelle des altérations structurelles liées à l'ARHL. Notamment, bien que ces données soient dérivées de donneurs sains, des études antérieures ont utilisé ces données pour explorer les signatures transcriptionnelles des altérations structurelles dans les troubles neuropsychiatriques et les maladies neurodégénératives liées à l'âge. En particulier, une étude récente a utilisé ces données pour enquêter sur la relation entre l'expression génique et l'association entre la capacité auditive chez les adultes âgés et la morphologie corticale. Étant donné que seuls deux donneurs contenaient des données d'expression génique de l'hémisphère droit, nous avons restreint l'analyse à l'hémisphère gauche. Nous avons prétraité les données de microarray en utilisant le package Python abagen, qui comprenait (1) la mise à jour des coordonnées MNI de tous les échantillons de tissus, (2) la réannotation des mappages de sonde-à-gène de microarray, (3) le filtrage basé sur l'intensité des sondes, (4) la sélection des sondes basée sur la stabilité différentielle la plus élevée chez les donneurs à partir des sondes, (5) le mappage des échantillons de tissus aux régions définies par la parcellisation Schaefer-400, (6) la normalisation des données d'expression en utilisant une fonction sigmoïde robuste mise à l'échelle, (7) le calcul des valeurs d'expression régionales. Lorsque aucun des donneurs n'a assigné un échantillon de tissu à une région dans la parcellisation fonctionnelle, la valeur d'expression de l'échantillon de tissu le plus proche du centroïde de la région sera assignée à cette région. Le processus a finalement produit des valeurs d'expression de 15 633 gènes dans 200 régions. Nous avons utilisé une régression par moindres carrés partiels (PLS) pour évaluer l'association entre les différences de groupe dans les gradients et les profils de transcription génique. La régression PLS a extrait des composants qui étaient liés aux différences de groupe dans les gradients à partir des profils de transcription de 15 633 gènes. Conformément aux travaux antérieurs, la signification statistique de la variance expliquée par les composants PLS a été évaluée par 10 000 tests de permutation. Nous avons calculé la corrélation spatiale entre les scores PLS et les différences cas-témoins dans les gradients structurels et évalué sa signification statistique via 10 000 tests de permutation de rotation. La variabilité du poids PLS a été estimée en utilisant 2 000 rééchantillonnages bootstrap de 200 régions cérébrales. Le score Z du poids PLS a été évalué comme le poids divisé par son écart-type bootstrap. Selon les scores Z des poids PLS, nous avons choisi des gènes significatifs (tests Z à un échantillon, p corrigé < 0,05) pour l'analyse ultérieure. Basé sur le signe des poids PLS, les gènes sélectionnés ont été catégorisés en deux ensembles (ensembles de gènes PLS+ et PLS-). Pour comprendre les implications fonctionnelles des gènes sélectionnés, nous avons effectué une analyse d'enrichissement fonctionnel pour les ensembles de gènes PLS+ et PLS-, respectivement, en utilisant le logiciel en ligne Metascape. Les catégories d'enrichissement comprenaient le processus biologique Gene Ontology (GO), la voie KEGG, WikiPathways, les voies canoniques et les ensembles de gènes Reactome. Les résultats de l'analyse d'enrichissement ont été ajustés par la méthode FDR, et le seuil de signification a été fixé à p corrigé < 0,05. Grâce à l'algorithme d'intégration de carte de diffusion, nous avons généré les trois premiers modèles de gradient structurel (G1, G2 et G3). Les trois gradients représentaient environ 43,33 % de la variance totale dans le connectome modèle. Conformément à la littérature précédente, le premier gradient (G1) capture une organisation hiérarchique de gauche à droite. Le deuxième gradient (G2) reflète une hiérarchie traversant de l'avant à l'arrière. Le troisième gradient (G3) délimite un axe hiérarchique où les régions préfrontales et pariétales/motrices latérales sont situées à des extrémités opposées. Pour assurer une comparabilité directe des gradients structurels entre les individus et les groupes, nous avons aligné les gradients structurels individuels sur les gradients modèles en utilisant l'alignement de Procrustes. Les trois premiers gradients structurels des moyennes de groupe pour les groupes de contrôle et ARHL ont été présentés dans la Figure S1 supplémentaire. Inspectés visuellement, leurs motifs spatiaux sont très similaires aux gradients modèles. Dans cette section, nous avons examiné si l'ARHL altérait les gradients structurels, et si oui, si ces altérations étaient concentrées dans des systèmes fonctionnels spécifiques. Nous avons effectué des analyses multivariées en utilisant le T de Hotelling pour étudier les effets partagés à travers les trois premiers gradients. Les analyses au niveau du réseau ont montré que, par rapport aux témoins, les patients atteints d'ARHL présentaient des altérations significatives de l'organisation du connectome structurel à travers plusieurs réseaux, y compris les réseaux somatomoteur, d'attention dorsale, limbique et en mode par défaut. Nous avons ensuite effectué des comparaisons cas-témoins dans un gradient unique. Nous n'avons détecté aucune différence significative dans G1 et G2. Pour G3, nous avons observé des scores de gradient significativement réduits dans les réseaux somatomoteur et d'attention dorsale, et des scores de gradient significativement augmentés dans les réseaux limbique et en mode par défaut chez les patients atteints d'ARHL. Les résultats détaillés des analyses au niveau du réseau ont été rapportés dans le Tableau S1 supplémentaire. Nous avons ensuite exploré les différences entre les groupes dans l'organisation hiérarchique à travers les trois premiers gradients au niveau régional. Les analyses multivariées ont révélé des différences significatives entre les groupes dans les gradients structurels dans plusieurs zones corticales. Ces régions étaient principalement situées dans le cortex pariétal latéral, le cortex moteur, le lobule paracentral, le cortex temporal latéral, le cingulaire, les zones visuelles droites et le cortex préfrontal (en particulier le cortex orbitofrontal). L'analyse de décodage fonctionnel a suggéré que ces régions significatives étaient principalement liées aux fonctions motrices. Pour les comparaisons de gradient unique, les analyses post-hoc ont indiqué que les différences de groupe dans les gradients structurels étaient présentes dans G2 et G3. Plus précisément, pour G2, les patients atteints d'ARHL ont montré des scores de gradient significativement plus élevés dans deux régions situées respectivement dans le cingulaire gauche et le pôle temporal droit. En revanche, les patients atteints d'ARHL ont présenté des scores de gradient plus faibles dans une région du cortex pariétal supérieur droit. Pour G3, des scores de gradient plus faibles ont été observés dans les régions précentrales, postcentrales, paracentrales et pariétales supérieures bilatérales chez les patients atteints d'ARHL. Inversement, des scores de gradient plus élevés ont été observés dans les régions préfrontales médiales gauches et visuelles droites chez les patients atteints d'ARHL. En utilisant des gradients pondérés sous-corticaux, nous avons étudié les différences entre les groupes dans la connectivité sous-corticale-corticale. Les analyses multivariées ont révélé des altérations significatives liées à l'ARHL dans les gradients pondérés sous-corticaux dans le caudé gauche, le noyau accumbens gauche, l'hippocampe droit et l'amygdale droite. Lors de comparaisons dans un gradient unique, des différences significatives entre les groupes dans les valeurs de degré des gradients pondérés sous-corticaux ont été détectées dans G1 et G2. Plus précisément, pour G1, les patients atteints d'ARHL ont montré des valeurs de degré significativement réduites dans l'amygdale droite. Pour G2, les patients atteints d'ARHL avaient des valeurs de degré significativement augmentées dans l'amygdale droite. Les détails des différences dans la connectivité sous-corticale-corticale peuvent être trouvés dans le Tableau S3 supplémentaire. Nous avons fourni deux tableaux supplémentaires (Tableaux S4–S5 supplémentaires) pour résumer systématiquement les résultats significatifs des analyses multivariées et univariées. En utilisant les données post-mortem de la base de données AHBA et la régression par moindres carrés partiels (PLS), nous avons demandé si les anomalies dans les gradients structurels étaient liées aux profils d'expression génique. Nous avons constaté que les composants PLS1 et PLS2 représentaient respectivement 15 % et 16 % de la variance dans les différences de groupe dans les gradients, dépassant significativement l'attente nulle (p = 0,0015). Nous nous sommes concentrés sur le composant PLS2 pour explorer les associations transcriptomiques car il expliquait la plus grande variance dans nos modèles PLS. Nous avons constaté que le schéma d'expression génique pondéré PLS2 était significativement corrélé avec les différences entre les groupes dans les gradients structurels. (Pearson'r = 0,40, p = 0,0025). En utilisant le logiciel en ligne Metascape, nous avons mené des analyses d'enrichissement de jeux de gènes pour évaluer la signification biologique des gènes contribuant fortement au composant PLS2. Les contributions des gènes ont été définies selon leurs poids normalisés. Basé sur des tests Z à un échantillon, nous avons extrait des gènes PLS2 significatifs, y compris 556 gènes PLS2+ (Z > 2,89, p corrigé < 0,05) et 627 gènes PLS2- (Z < -2,89, p corrigé < 0,05). Nous avons choisi des termes d'enrichissement significatifs (p corrigé < 0,05) et supprimé les clusters d'enrichissement discrets. L'analyse d'enrichissement a révélé que les gènes PLS2+ étaient le plus fortement enrichis avec le transport transmembranaire d'ions inorganiques (processus biologique GO) et le cytosquelette dans les cellules musculaires (voie KEGG). Les gènes PLS2- étaient significativement enrichis pour les termes GO liés à la régulation biologique et à la régulation des processus biologiques, tels que la régulation négative de la transduction du signal intracellulaire, la régulation du potentiel de membrane et la modulation de la transmission synaptique chimique. Les résultats détaillés des analyses d'enrichissement sont présentés dans les Tableaux S6–S7 supplémentaires. Nous avons répété nos analyses multivariées sous diverses considérations méthodologiques, y compris (1) la construction des gradients modèles basés sur le connectome structurel moyen du groupe dérivé exclusivement du groupe de contrôle ; (2) le calcul de la matrice d'affinité en utilisant d'autres mesures de similarité, y compris la corrélation de rang de Spearman et la similarité d'angle normalisée ; (3) l'application de différents seuils pour raréfier la matrice de connexion structurelle (niveaux de rareté incluant 0,7, 0,8 et 0,9) ; (4) l'utilisation de différents paramètres de réglage de l'intégration de carte de diffusion ((t, α) = (0, 0,2), (0, 0,8) et (1, 0,5)) ; (5) l'alignement des gradients au niveau individuel avec les gradients modèles par intégration conjointe, au lieu de l'alignement de Procrustes ; (6) les comparaisons entre les groupes incluant le mouvement absolu moyen des données de diffusion individuelles ou les valeurs aberrantes totales des images de diffusion individuelles, dérivées du processus de correction d'eddy de FSL, comme covariable. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de différences significatives dans ces deux métriques entre les groupes de contrôle et ARHL (Contrôle-ARHL, le mouvement absolu moyen : t de Student = -1,66, p-value = 0,10 ; valeurs aberrantes totales : t de Student = -0,46, p-value = 0,64). Les résultats de l'analyse de sensibilité sont présentés dans les Figures S4–S9 supplémentaires. Pour évaluer la robustesse, nous avons calculé l'indice de Dice entre les résultats significatifs de l'analyse principale et ceux de l'analyse de sensibilité. Les indices de Dice pour les analyses de gradients au niveau du réseau, au niveau régional et pondérés sous-corticaux étaient respectivement de 0,84 ± 0,20, 0,71 ± 0,22 et 0,85 ± 0,16 (Tableau S8 supplémentaire), suggérant que nos résultats présentaient une bonne cohérence à travers diverses considérations méthodologiques. Nous avons validé nos résultats en utilisant un atlas cérébral différent (atlas de Glasser). Nous avons constaté que les résultats de vérification étaient très cohérents avec les résultats principaux (Figure S10 supplémentaire). Nous avons également ajouté une parcellisation alternative dérivée de la stratification cytoarchitectonique de von Economo et Koskina, qui a regroupé 400 régions en cinq types structurels distincts : agranulaire, frontal, pariétal, polaire et granulaire. Nous avons constaté que les patients atteints d'ARHL présentaient des gradients structurels significativement anormaux dans trois types structurels, y compris agranulaire, frontal et polaire (Figure S11 supplémentaire). Étant donné qu'il y avait un déséquilibre dans la taille de l'échantillon entre les groupes de contrôle (28 participants) et ARHL (49 participants). Nous avons effectué un appariement optimal des groupes en utilisant le package R MatchIt, avec le groupe comme variable de traitement et l'âge et le sexe comme covariables. Ce processus a produit un sous-ensemble comprenant 28 témoins et 28 patients atteints d'ARHL. Nous avons répété notre analyse principale dans ce sous-ensemble. Les indices de Dice pour les analyses de gradients au niveau du réseau, au niveau régional et pondérés sous-corticaux étaient respectivement de 0,74, 0,99 et 1, indiquant une bonne reproductibilité (Figure S12 supplémentaire, Tableau S8 supplémentaire). Dans la présente étude, nous avons utilisé le cadre de cartographie de gradient pour étudier l'organisation hiérarchique du connectome structurel chez les patients atteints d'ARHL. Nous avons constaté que les patients atteints d'ARHL présentaient des perturbations de l'organisation du connectome dans plusieurs réseaux fonctionnels, y compris les réseaux somatomoteur, d'attention dorsale, limbique et en mode par défaut. Les analyses multivariées au niveau régional ont révélé des gradients structurels atypiques principalement dans le cortex pariétal latéral, le cortex temporal latéral, le cingulaire, les zones visuelles droites, somatomotrices et le cortex orbitofrontal. Les analyses univariées ont en outre indiqué que ces altérations dans les gradients structurels étaient concentrées dans le troisième gradient, les patients atteints d'ARHL montrant des scores de gradient significativement réduits dans les zones somatomotrices et pariétales supérieures. En utilisant des gradients pondérés sous-corticaux, nous avons observé des différences significatives entre les groupes dans la connectivité sous-corticale-corticale dans le caudé gauche, le noyau accumbens gauche, l'hippocampe droit et l'amygdale droite. Les analyses d'association transcriptomique ont suggéré que ces altérations dans les gradients structurels étaient liées à des profils d'expression génique pondérés, avec des gènes contribuant fortement principalement enrichis pour la voie "Cytosquelette dans les cellules musculaires", le transport transmembranaire d'ions inorganiques et la régulation des processus biologiques. En somme, ces résultats fournissent des preuves de la réorganisation des gradients structurels chez les patients atteints d'ARHL et révèlent des mécanismes moléculaires potentiels derrière ces changements. Les recherches antérieures ont démontré que les patients atteints d'ARHL présentent une intégrité de la matière blanche significativement aberrante (par exemple, une anisotropie fractionnelle réduite), une force de connectivité structurelle altérée et des différences subtiles dans les métriques de graphe des connectomes structurels. Ici, nous étendons ces résultats d'IRM de diffusion dans l'ARHL en utilisant une méthode de cartographie de gradient qui compresse les connectomes structurels de haute dimension en une gamme de représentations continues de faible dimension dans l'espace intégré. Des études antérieures utilisant une méthodologie similaire ont rapporté une hiérarchie anormale du connectome structurel macroscopique dans les cortex somatomoteur et d'association chez les patients atteints d'autisme, ainsi qu'une organisation du connectome structurel perturbée dans les régions sensorielles et limbiques chez les patients souffrant de migraine épisodique. Par des analyses multivariées aux niveaux du réseau et régional, nous avons constaté que les patients présentaient des anomalies de gradient structurel larges et distribuées à travers les régions corticales, s'étendant du cortex sensoriel primaire (par exemple, les régions somatomotrices et visuelles droites) au cortex cognitif de haut niveau (par exemple, les régions orbitofrontales et pariétales inférieures). Les réorganisations de gradient structurel observées dans les régions sensorielles primaires peuvent provenir de la compensation du cortex sensoriel primaire en réponse à une entrée auditive altérée. En revanche, les anomalies de gradient structurel dans les régions d'association de haut niveau sont probablement associées à des déficits cognitifs. De plus, nos résultats sont en accord avec les preuves émergentes selon lesquelles l'ARHL implique une perturbation de systèmes multi-réseaux. Les analyses post-hoc et les analyses univariées au niveau du gradient unique ont suggéré que les effets globaux de l'ARHL sur les gradients structurels étaient principalement contribué par G3. Dans cette étude, G3 représente un axe spatial où les valeurs de gradient les plus élevées se trouvent dans les régions pariétales/motrices tandis que les valeurs les plus basses se trouvent dans les régions préfrontales. Fait intéressant, nous avons observé des valeurs de gradient significativement réduites dans les régions somatomotrices et pariétales, ainsi que des valeurs augmentées dans les régions préfrontales gauches chez les patients atteints d'ARHL, suggérant une organisation hiérarchique comprimée. Les réseaux ou régions avec des différences significatives que nous avons identifiées chevauchent dans une certaine mesure les études antérieures basées sur l'IRMf chez les patients atteints d'ARHL. Par exemple, des études antérieures ont rapporté une connectivité fonctionnelle altérée au sein du réseau en mode par défaut et des organisations fonctionnelles anormales du réseau visuel chez les patients atteints d'ARHL. Une étude récente a appliqué la méthode d'intégration de cartographie de diffusion au connectome fonctionnel et a trouvé des gradients fonctionnels significativement altérés dans les réseaux visuel, en mode par défaut, somatomoteur, frontopariétal et limbique. Nos résultats fournissent un substrat structurel potentiel pour les anomalies fonctionnelles généralisées du connectome rapportées chez les patients atteints d'ARHL. Des études supplémentaires sont nécessaires pour intégrer les données fonctionnelles et de diffusion pour disséquer comment les réorganisations du connectome structurel affectent le connectome fonctionnel chez les patients atteints d'ARHL. Par méta-analyse, nous avons observé que les régions avec des différences significatives étaient principalement liées à des termes cognitifs liés au mouvement tels que l'imagerie motrice et prémotrice. Des études antérieures ont suggéré une diminution du traitement auditivo-moteur de la parole pour les patients atteints d'ARHL, indiquant une intégration réduite du cortex moteur pendant le traitement phonologique. Cependant, en raison du manque de niveaux détaillés de fonction motrice chez les patients, le lien direct entre les gradients structurels altérés et la fonction motrice mérite une enquête plus approfondie. À travers des analyses multivariées et univariées aux niveaux du réseau et régional, nous avons observé que les tailles d'effet importantes et la grande signification statistique pour les différences entre les groupes dans les gradients structurels étaient situées dans les régions somatomotrices, ainsi que dans le lobule pariétal supérieur. Des études antérieures indiquent que ces régions pourraient être impliquées dans la pathologie de l'ARHL. Par exemple, les patients atteints d'ARHL présentent des gradients fonctionnels altérés dans le réseau somatomoteur, et une centralité d'intermédiarité accrue du réseau fonctionnel dans le gyrus postcentral droit. De plus, l'ARHL peut affecter la connectivité fonctionnelle en état de repos entre le réseau d'attention dorsale et le lobule pariétal supérieur. Une étude précédente a suggéré que le système somatomoteur agit comme un hub transdiagnostique qui est associé à la dysfonction cognitive, à la psychopathologie générale et à l'impulsivité. Nos résultats offrent un soutien supplémentaire pour la pertinence pathologique des régions somatomotrices et pariétales supérieures, impliquant que cibler ces régions contribue potentiellement au diagnostic et au traitement de l'ARHL. Les altérations de la hiérarchie du connectome structurel observées chez les patients atteints d'ARHL indiquent l'anomalie de la structure de la matière blanche, ce qui est compatible avec les altérations précédemment rapportées de l'intégrité de la matière blanche chez les patients atteints d'ARHL. Il convient de noter que les anomalies de l'intégrité de la matière blanche se trouvent dans les régions cérébrales liées à l'audition. De même, nous avons observé des gradients structurels altérés dans la région du lobe temporal supérieur gauche près du cortex auditif. De plus, contrairement aux anomalies locales de l'intégrité de la matière blanche, nous avons observé des altérations de gradient structurel étendues allant des régions sensorielles aux régions d'association. Nous supposons que les altérations à long terme des entrées sensorielles locales se propagent et affectent plusieurs systèmes fonctionnels (par exemple, les réseaux somatomoteur et en mode par défaut), perturbant finalement les fonctions cognitives de haut niveau. Des études antérieures sur l'autisme et la schizophrénie ont observé un effet en cascade comparable, où les anomalies dans le système sensoriel impactent les systèmes cognitifs supérieurs. Une étude récente suggère que les enfants atteints de perte auditive neurosensorielle congénitale présentent une réorganisation fonctionnelle impliquant les cortex auditif, somatique moteur, visuel et préfrontal. Cela est cohérent avec nos résultats, impliquant qu'une fonction auditive anormale peut entraîner des altérations généralisées à travers plusieurs systèmes. Basé sur le cadre de cartographie de gradient, des travaux antérieurs ont démontré que le processus de vieillissement et les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la démence frontotemporale présentent une organisation hiérarchique altérée du connectome fonctionnel dans des réseaux spécifiques tels que le mode par défaut, somatomoteur et les réseaux d'attention ventrale. Bien que ces réseaux rapportés chevauchent partiellement nos résultats sur l'ARHL, ces études sont basées sur le connectome fonctionnel. Les recherches futures devraient enquêter davantage sur la question de savoir si et comment d'autres processus atypiques liés à l'âge modifient l'organisation hiérarchique du connectome structurel, pour déterminer s'il y a un chevauchement avec nos résultats. Plusieurs études ont documenté des changements notables dans les structures sous-corticales des patients atteints d'ARHL, y compris l'atrophie de l'hippocampe et de l'amygdale, une connectivité fonctionnelle accrue entre le caudé et le gyrus supramarginal droit, et une connectivité fonctionnelle dirigée réduite entre l'hippocampe et les zones corticales. En utilisant des gradients pondérés sous-corticaux, nous avons observé une connectivité structurelle sous-corticale-corticale altérée dans le caudé gauche, le noyau accumbens gauche, l'hippocampe droit et l'amygdale droite. Notre constatation, combinée aux résultats précédents, fournit des preuves émergentes que ces régions sous-corticales sont intimement liées à la pathologie de l'ARHL. Ces structures sous-corticales sont généralement impliquées dans les processus moteurs, la mémoire et l'apprentissage, reflétant partiellement les fonctions cognitives des zones corticales que nous avons identifiées. Cette constatation a en outre suggéré que les patients atteints d'ARHL présentent probablement des altérations qui s'étendent du moteur primaire aux systèmes cognitifs de haut niveau. Les comparaisons multivariées et de gradient unique ont systématiquement démontré que l'amygdale droite avait l'effet le plus fort des différences entre les groupes. Étant donné le rôle crucial de l'amygdale dans la réponse émotionnelle et la cognition sociale, nous supposons que la connectivité sous-corticale-corticale anormale dans l'amygdale droite pourrait provenir de l'isolement social et de la solitude causés par la perte auditive à long terme. Collectivement, nos résultats soulignent que les régions sous-corticales, en particulier l'amygdale, sont cruciales pour comprendre le mécanisme pathologique derrière l'ARHL. En utilisant les données transcriptomiques de la base de données AHBA, nous avons identifié un lien entre les changements liés à l'ARHL dans les gradients structurels et les profils d'expression génique pondérés. L'analyse d'enrichissement a informé que les gènes les plus corrélés étaient principalement enrichis pour la voie "Cytosquelette dans les cellules musculaires" et plusieurs processus biologiques, y compris le transport transmembranaire d'ions inorganiques (GO:0098660) et des termes liés à la régulation des processus biologiques. Ces termes que nous avons identifiés présentent certaines correspondances avec les mécanismes moléculaires associés à l'ARHL tels que rapportés dans la littérature antérieure. Plus précisément, des études antérieures ont suggéré que des canaux ioniques et des protéines de transport spécifiques (par exemple, le canal K+ KCNQ4) sont cruciaux pour une audition normale. Le processus de vieillissement perturbe l'homéostasie des protéines dans l'oreille interne, entraînant des altérations de l'homéostasie ionique qui induisent une dysfonction liée à l'ARHL. Les expériences animales indiquent également que la régulation de potentiels de membrane spécifiques (par exemple, le potentiel de membrane mitochondrial) peut être associée à l'ARHL. Nos résultats d'imagerie-transcriptomique contribuent à la compréhension des substrats moléculaires sous-jacents à l'ARHL. Il y a quelques limitations à nos résultats qui méritent d'être prises en compte. Premièrement, la taille d'échantillon relativement modeste dans la présente étude pourrait limiter la généralisabilité de nos résultats. Les études futures pourraient utiliser un grand échantillon pour valider nos résultats. Deuxièmement, en raison du manque d'informations détaillées sur la gravité de la perte auditive, le statut cognitif et les comportements, nous ne sommes pas en mesure d'explorer les impacts de ces facteurs sur les différences de gradient structurel. Des recherches supplémentaires visant à étudier si la réorganisation du connectome structurel est liée à ces facteurs seraient d'une grande importance. Troisièmement, nos résultats sont basés sur des données de neuroimagerie unimodales. Les études futures pourraient intégrer d'autres types de données (par exemple, l'IRM fonctionnelle, la spectroscopie par résonance magnétique ou les données longitudinales) pour valider et étendre davantage nos résultats. Enfin, nos analyses d'association transcriptomique reposaient sur des données d'expression génique obtenues à partir de donneurs sans ARHL. Les études futures devraient tirer parti des données transcriptomiques des patients atteints d'ARHL pour valider davantage nos résultats. Les contributions originales présentées dans l'étude sont incluses dans l'article/matériel supplémentaire, des demandes de renseignements supplémentaires peuvent être adressées aux auteurs correspondants. Les données d'imagerie dé-identifiées utilisées dans cette étude ont été obtenues à partir du jeu de données disponible publiquement sur OpenNeuro. Les acquisitions de données impliquant des humains ont été approuvées par le comité d'éthique institutionnel de l'Université de Salerne. Un consentement éclairé écrit a été obtenu de chaque participant avant l'acquisition de l'IRM. YZhen : Investigation, Méthodologie, Visualisation, Rédaction – brouillon original, Rédaction – révision et édition. HZ : Investigation, Rédaction – révision et édition. YZheng : Investigation, Visualisation, Rédaction – révision et édition. ZZ : Investigation, Ressources, Supervision, Rédaction – révision et édition. YY : Investigation, Méthodologie, Visualisation, Rédaction – révision et édition. ST : Acquisition de financement, Investigation, Rédaction – révision et édition. Les auteurs déclarent avoir reçu un soutien financier pour la recherche et/ou la publication de cet article. Ce travail a été soutenu par le Projet Majeur National de Science et Technologie, le Programme de la Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine, les Fonds de Recherche Fondamentale pour les Universités Centrales, et la Fondation des Sciences Naturelles de Pékin. Les auteurs déclarent que la recherche a été menée en l'absence de toute relation commerciale ou financière qui pourrait être interprétée comme un conflit d'intérêt potentiel. Les auteurs déclarent qu'aucune IA Générative n'a été utilisée dans la création de ce manuscrit. Toutes les affirmations exprimées dans cet article sont uniquement celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de leurs organisations affiliées, ou celles de l'éditeur, des éditeurs et des réviseurs. Tout produit qui pourrait être évalué dans cet article ou toute revendication qui pourrait être faite par son fabricant n'est pas garanti ou approuvé par l'éditeur. Le matériel supplémentaire pour cet article peut être trouvé en ligne à : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2025.1555553/full#supplementary-material 🔗 **Fuente:** https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1555553/full